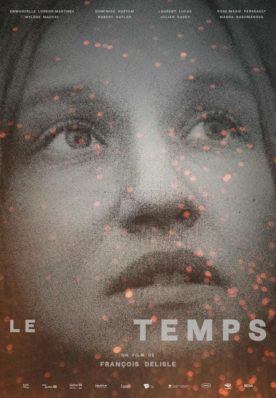Après avoir vu The Twentieth Century, il ne faisait aucun doute que Matthew Rankin savait conjuguer une histoire déjantée avec un univers visuel surréaliste. L’originalité de son approche du cinéma et sa capacité à en faire un art de l’émerveillement sont de nouveau à l’œuvre dans cet inclassable Une langue universelle, mélange déroutant d’humour absurde, d’humanisme naïf et de satire.

Retournant dans son Winnipeg natal, Rankin crée un film unique et fascinant, ce qui est d’autant plus remarquable qu’il avait assez peu de moyens à sa disposition. Des quartiers populaires uniformes aux murs de briques ternes, des stationnements intérieurs multiétagés, des pans d’architectures brutalistes, des bretelles d’autoroutes hideuses, des cimetières perdus au milieu de nulle part; le Winnipeg d’Une langue universelle est assurément le théâtre de moult surprises.
Dans cette ville dont les habitants ne perçoivent plus la singularité à force de la côtoyer, Rankin s’amuse à inventer un pays hybride, juxtaposant des éléments canadiens familiers (Tim Hortons, l’omniprésence de l’automobile, le bingo, le curling…) à la culture persane. La bizarrerie est partout. Dans les magasins improbables, dans les personnages irréels, dans les pubs télé hideuses, et même dans la présence d’une dinde (de concours, attention!) qui devient un vrai personnage de suspense.
Comme dans son précédent long, le propos politique de Rankin se révèle toujours aussi mordant. Ici, il honore la mémoire de Louis Riel, fondateur du Manitoba, défenseur de la cause autochtone et véritable héros oublié de l’histoire canadienne. La séquence, hilarante, de la demi-heure de silence en son hommage, ouvre sur l’un des aspects les plus intéressants du film. Car ce que nous demande Rankin c’est de se laisser aller à la surprise et à la découverte, en jetant, en premier lieu, un oeil neuf sur notre environnement. Même la bâtisse la plus banale devient, sous le regard de Rankin, un monument porteur d’histoire et de patrimoine, un trésor à préserver.
Dans les périmètres les plus ordinaires, il y a des humains que l’on devrait aussi découvrir et aimer, comme le rappelle le carton sur lequel est inscrit « Au nom de l’amitié » placé en guise d’introduction du film. Le ton est donné. La diversité canadienne est peut-être une part importante de l’ADN du pays, il faudrait qu’elle soit encore plus vivante, plus évidente. Rankin rêve de ce Tim Hortons réinventé en salon de thé convivial, où chacun peut venir se réchauffer et jouer aux cartes avec les amis. Du reste, le pince-sans-rire Rankin n’est pas dupe et ne se prive pas d’évoquer l’ignorance de l’Autre et la méconnaissance de nos provinces. À ce chapitre, le running gag Alberta/Manitoba est aussi désopilant qu’il vise juste.
Avec ses longs plans fixes et ses cadrages méticuleux, la mise en scène possède un esprit de liberté qui transforme des lieux ordinaires en tableaux d’une beauté surprenante. Certes, le rythme du film est un peu saccadé et sa finale paraît trop bricolée pour convaincre vraiment, mais la présence des jeunes acteurs non professionnels apporte une sincérité touchante qui fait oublier les écueils.
Une langue universelle permet de s’immerger dans un univers souvent captivant et totalement inédit, offrant un regard à la fois tendre et acéré sur notre société. Ainsi, en seulement deux longs métrages, Rankin s’est imposé comme l’un des réalisateurs canadiens les plus audacieux de sa génération, façonnant un cinéma singulier et profondément évocateur.