
Pierre-Alexandre Fradet
Dans son récent ouvrage Philosopher à travers le cinéma québécois, Pierre-Alexandre Fradet, docteur en philosophie de l’ENS Lyon et de l’université Laval, démontre que le cinéma d’ici pourrait être un vibrant porte-étendard de la philosophie. Pour étayer sa thèse, l’auteur a choisi d’analyser et de décortiquer – comme personne ne l’avait fait auparavant – certains films de figures marquantes du corpus québécois, à savoir Xavier Dolan, Denis Côté, Stéphane Lafleur, Rafaël Ouellet, Anne Émond, Mathieu Denis ou encore Simon Lavoie. Le cinéma de ces cinéastes appartenant à une mouvance dite « du renouveau » n’a pas fini de livrer ses secrets. Nous avons posé quelques questions à M. Fradet afin d’en savoir un peu plus sur le rapport qu’entretiennent la philosophie et le cinéma québécois contemporain.
Le cinéma est indéniablement un outil réflexif dont la portée va bien au-delà de la valeur esthétique associée à l’image ou du divertissement proposé. Selon vous, en quoi le cinéma – pas uniquement québécois d’ailleurs – peut-il aider à enseigner la philosophie?
Je tiens d’abord à vous remercier pour vos questions, qui sont tout à fait pertinentes et me permettent d’éclairer ici certains des éléments de ma modeste réflexion.
Il existe au minimum trois rapports analytiques possibles entre la philosophie et le cinéma. Un rapport théorique, d’abord : la philosophie peut se pencher sur le cinéma pour le commenter et le théoriser. Un rapport illustratif, ensuite : le cinéma peut servir à mettre en images des thèses philosophiques. Et un rapport réflexif, enfin : le cinéma peut développer par lui-même des réflexions philosophiques, c’est-à-dire agir comme opérateur de pensée. Tout au long de mon parcours intellectuel et de mon récent livre en particulier, je crois osciller d’un rapport à un autre. Tous trois revêtent à vrai dire un indéniable intérêt et permettent de répondre à des questions distinctes, mais d’égale importance. En ce qui concerne le second rapport, je pense non seulement que le cinéma peut permettre d’illustrer la philosophie, mais que la philosophie elle-même est capable d’« illustrer le cinéma ». Car les concepts philosophiques peuvent devenir des moyens de faire naître des images mentales complémentaires à celles du cinéma et, ainsi, ils peuvent éclairer et prolonger l’expérience cinématographique.
Il est devenu fréquent en philosophie du cinéma de privilégier le troisième angle d’analyse. Lui seul, répète-t-on souvent, permet de rendre justice aux films commentés, puisqu’il implique de faire ressortir ce que le cinéma crée comme idées, au lieu de réduire le 7e art à des idées conçues d’avance en philosophie. Que le cinéma et l’art doivent maintenir une certaine autonomie de forme et de contenu face aux autres champs d’activité, comme la philosophie, voilà qui est reconnu depuis belle lurette. Déjà à l’époque moderne, sous l’impulsion des travaux de Baumgarten, Sulzer et Kant, la sphère artistique tendait vers l’autonomie. Mais on appauvrirait démesurément l’identité de l’art en le plaçant dans des limites étroites et en l’empêchant d’interagir avec les autres sphères que sont l’ontologie, l’éthique, la politique, la spiritualité, pour ne mentionner qu’elles. C’est ce qu’explique en somme Carole Talon-Hugon dans un ouvrage fort recommandable, L’Art victime de l’esthétique. Or, à mon avis, l’art peut être envisagé tantôt dans un quasi-isolement face à ce qu’il n’est pas (lorsqu’on cherche à clarifier son identité, aussi mouvante soit-elle), tantôt dans un rapport d’ouverture aux autres champs (lorsqu’on convient du fait que l’hétéronomie permet d’enrichir l’art). Et c’est en partie pourquoi il s’avère bien possible d’utiliser parfois le 7e art comme un moyen de faire comprendre des thèses philosophiques.
Au sein de mon ouvrage, en suivant cette fois le troisième rapport analytique possible, j’ai été très attentif aux intuitions et aux réflexions qui émanaient des œuvres filmiques elles-mêmes, comme je l’explique dans un entretien paru ailleurs [1]. Mais je persiste à croire que le fait d’employer par moments le cinéma à des fins pédagogiques n’a rien de déshonorant. Cela peut s’avérer en effet très profitable, notamment dans le cadre d’un cours de philosophie de l’art – type de cours que j’ai moi-même le plaisir de donner en ce moment au Cégep de St-Laurent. Autre fait à noter : ce n’est pas parce qu’on « emploie » parfois le cinéma comme « illustrateur » qu’on l’instrumentalise de part en part. Il est fréquent de constater qu’au sein même des images filmiques qu’on utilise pour offrir des illustrations d’idées philosophiques, viennent se loger un ensemble de nuances, de bémols, de codicilles, voire des pratiques et des idées neuves qui forcent à redéfinir les arguments de la philosophie. La pédagogie philosophique, à cet égard, ne fait pas du tout obstacle à la créativité artistique et filmique ; elle s’en nourrit.
En écho à votre remarque sur mon intérêt pour le cinéma québécois : il va sans dire que les cinémas venus de partout ont une portée philosophique, et pas uniquement celui de la « Belle Province ». En m’intéressant au cinéma québécois dans mon ouvrage, je m’oppose d’ailleurs, d’une certaine façon, à tout repli identitaire, puisque mon but est justement d’expulser ce cinéma hors de sa bulle culturelle en le faisant dialoguer avec autre chose que lui-même.
Vous avez choisi des cinéastes à qui l’on accole généralement une voix d’auteur forte couplée à des choix stylistiques originaux, pour ne pas dire atypiques. Est-ce que l’on peut établir des parallèles entre leurs dimensions philosophiques, et celles de cinéastes renommés qui ne font pas partie du « renouveau » (Philippe Falardeau, Robert Morin, Jean-Marc Vallée, Sébastien Pilote, pour ne citer qu’eux)?
On peut très volontiers chercher à établir des parallèles entre les dimensions philosophiques des œuvres du renouveau et celles d’autres cinéastes, renommés ou non. S’agissant de Sébastien Pilote, par exemple, certains l’associent sans détour au renouveau, même si la question de savoir s’il en fait partie demeure ouverte. La thèse doctorale dont est issu mon livre traitait d’ailleurs directement de l’œuvre de Pilote, en particulier du Vendeur. Je regrette un peu d’avoir retranché du produit publié l’analyse que je faisais de son œuvre, mais certains facteurs m’y ont conduit, comme le désir d’éviter de trop allonger l’ouvrage et le souci de m’attarder sur les œuvres filmiques qui abordent en priorité le rapport entre le réel et le sens commun. Peut-être vais-je faire paraître ailleurs en une version bonifiée les analyses que j’ai dû retrancher dans le livre, et dont certaines ont déjà fait l’objet de présentations succinctes lors de colloques.

Gilbert Sicotte et Nathalie Cavezzali, étincelants dans Le vendeur – © Films Séville
Dans Philosopher à travers le cinéma québécois, j’évoque l’œuvre de Pilote au passage, mais pas autant que je ne l’aurais souhaité. Sa réflexion est profonde et mériterait certainement davantage de considérations. Non seulement va-t-elle bien au-delà de la critique courante des diktats et des conséquences du capitalisme (« nous perdons notre vie à la gagner… »), mais elle est empreinte d’intuitions (le plus souvent inconscientes, sans doute) qui recoupent certaines idées captivantes de Stanley Cavell et de Quentin Meillassoux, entre autres. Il suffit d’être attentif à sa mise en scène et à son scénario pour voir que Pilote ne fait pas que déplorer sans nuance l’érosion d’une époque et l’effritement de la vie régionale. Dans le personnage principal du vendeur, me semble-t-il, on peut repérer une sorte de « coupable innocent », figure mystérieuse et joviale d’autant plus forte à l’écran qu’elle est paradoxale. Il s’agit là d’un coupable, puisqu’il vend à fort prix des voitures dont les gens n’ont pas besoin et qu’il veut transmettre cette habitude à son petit-fils. Mais c’est aussi un innocent, puisque ses actions relèvent d’un système économique qui le transcende et assure en même temps sa subsistance concrète. Sans nous faire adorer comme tel le personnage du vendeur, Pilote nous amène à le comprendre par un effet de sympathie qui se trouve renforcée par une musique aérienne, le relatif isolement dont l’homme est victime, sa naïveté manifeste… Pour cet homme, c’est la vente d’automobiles, donc son travail, qui est à la fois la cause du malheur des autres et le moyen incontournable de surmonter son deuil. À l’expression de Deleuze selon laquelle il faut « faire exister, non pas juger » [2], on pourrait donc peut-être bien substituer cette autre expression : « comprendre et accueillir, non pas juger ». Car s’en tenir à « faire exister » absolument tout aurait tôt fait de conduire au pire. Mieux vaut dès lors s’efforcer de comprendre, analyser et si nécessaire écarter de nos vies ce qui mérite de l’être. Mais parallèlement, quiconque a lu avec attention Nietzsche et Deleuze est forcé de reconnaître que le jugement critique pur et simple nourrit un ressentiment contre-productif, de sorte que c’est en adoptant une attitude d’hospitalité que l’on peut saisir toute la complexité des situations à analyser. Sur ce terrain, à travers la fascinante figure du vendeur, ce « coupable innocent », le cinéma de Pilote ne donne guère sa place. Et il faut lui en savoir gré.
Pour ce qui est de Philippe Falardeau, Robert Morin et Jean-Marc Vallée, dont j’apprécie sans conteste certaines des œuvres, on pourrait bien sûr mener une étude comparative entre eux et les cinéastes du renouveau, à condition toutefois qu’on tienne à préciser ce qu’ils ne partagent pas avec ces autres cinéastes. Superficiellement parlant, on pourrait distinguer Falardeau et Vallée (ainsi que Villeneuve) des cinéastes du renouveau en insistant sur les moyens parfois plus considérables dont ils disposent en ce moment pour réaliser leurs films, de même que sur leur rayonnement particulier aux États-Unis. Mais plus fondamentalement, on pourrait faire observer que leurs esthétiques et leurs thèmes de prédilection ne rejoignent pas vraiment celles et ceux du renouveau, dont l’humour et le propos s’expriment davantage en sourdine.
Quant à Robert Morin, il a été et demeure un mouton noir dans le paysage cinématographique au Québec. Même si toutes ses œuvres ne constituent pas forcément des sommets, sa voix d’auteur porte et continuera sans doute à porter. Elle est même mise si à l’avant dans ses films (au sens propre du terme, parfois) qu’elle permet de repérer une différence entre son œuvre et celles des cinéastes du renouveau, souvent plus mutiques. Je serais la personne la moins étonnée du monde d’apprendre que Morin n’aime pas être « rangé » au sein de quelque mouvance que ce soit, puisqu’il est devenu archi-commun de redouter les étiquettes en art en y voyant des cachots. Cela dit, dans le traitement que je propose des œuvres du renouveau, je comprends le terme « renouveau » non pas comme une étiquette fermée, mais plutôt comme une nébuleuse qui permet de faire saillir certaines sensibilités et certains thèmes (abordés chaque fois différemment) marquant la démarche de divers cinéastes.
Comme je le dis dans l’ouvrage lui-même, je ne prétends pas fournir une liste exhaustive de conditions nécessaires et suffisantes destinées à caractériser le renouveau, sans compter que je ne jure pas que par les œuvres de cette mouvance. À preuve, j’ai tenu à écrire ceci : « L’élévation au-dessus du quotidien pour atteindre l’ordinaire constitue-t-elle un trait commun aux œuvres du renouveau du cinéma québécois ? Sans vouloir mettre des frontières étanches à leur(s) cinéma(s) et aller jusqu’à dire que la préoccupation pour la question de l’ordinaire en représente une constante (il est souvent facile de trouver des contre-exemples lorsqu’on s’efforce d’examiner une mouvance filmique), nous pouvons au moins émettre l’hypothèse que ce thème constitue un air de famille répandu parmi les représentants du renouveau. » (p. 93) Et j’ai ajouté plus loin : « À l’instar de l’ensemble des courants qui comportent le terme “nouveau” ou le préfixe “néo”, le renouveau du cinéma québécois ne représente ni le sommet incontesté de ce qui se fait en cinéma aujourd’hui, ni – et encore moins – un achèvement artistique qui sonnerait le glas de l’histoire du septième art. Il n’en demeure pas moins que l’étiquette du renouveau rappelle explicitement (comme l’indiquait déjà Rafaël Ouellet) la capacité du cinéma à se renouveler concrètement et que les démarches de la nouvelle vague québécoise [expression écrite en minuscules par souci de distinguer cette mouvance des courants plus figés], au même titre que le Néoréalisme italien ou la Nouvelle Vague française, apportent à leur époque et à l’histoire du cinéma des pratiques, des intuitions et des réflexions qui appellent un examen détaillé. » (p. 188-189)
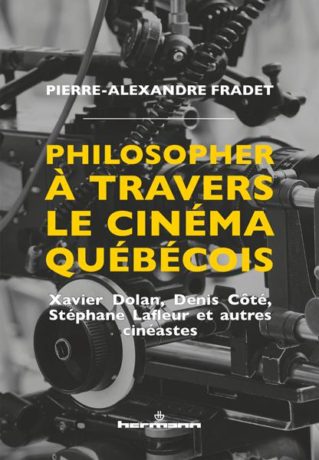
Couverture du livre Philosopher à travers le cinéma québécois (Hermann)
Vous associez ces cinéastes à une tendance – ou une mouvance – de renouveau du cinéma québécois. Est-ce que ce renouveau s’étend aussi au niveau de leur propos philosophique? En quoi leur approche du réel est-elle nouvelle par rapport aux cinéastes fondateurs par exemple?
Comme l’indiquait Stanley Cavell : « L’accent mis sur l’auteur nous détourne d’une proposition esthétique encore plus impossible à relever tant elle est évidente – qu’un film vient d’autres films. » [3] Puisque le cinéma est une entreprise fondamentalement collective, à la fois au cours de la préparation de l’œuvre (avec l’équipe de tournage), en aval (avec la postproduction) et en amont (parce qu’aucun film n’est forgé ex nihilo et que toute œuvre doit beaucoup à l’histoire du cinéma en particulier et à l’histoire en général), il serait un peu ridicule de faire comme si les divers cinéastes du renouveau généraient quelque chose d’absolument neuf, sans commune mesure avec ce qui vient avant eux. C’est en partie d’ailleurs ce que contribue à faire comprendre le collectif Épopée au Québec : tout film est le produit d’une rencontre. Mais en même temps, il serait tout aussi absurde d’inscrire les œuvres du renouveau dans une longue chaîne causale dont elles découleraient comme une conséquence prévisible. On peut toujours remonter de cause en cause, de préfiguration en préfiguration, ce qui risque de faire réapparaître l’antique problème de la régression à l’infini et surtout d’occulter la pertinence et la singularité, au moins partielles et circonstancielles, des œuvres que l’on commente, ici celles du renouveau.
À quels traits, dès lors, se reconnaissent les films du renouveau ? Sans pouvoir énumérer la totalité des lignes de force (dont le nombre demeure nécessairement ouvert et discutable) susceptibles de permettre de distinguer les cinéastes du renouveau de tout autre cinéaste, on pourrait évoquer en particulier leur lenteur assumée, leur économie du nombre de plans et leur désir de parler de politique indirectement plutôt que de front. Or, puisque le fond s’exprime toujours à travers la forme, il va de soi que leur propos philosophique, tel qu’il est véhiculé par l’image, apporte en lui-même un certain renouveau. Pour le démontrer au sein de l’ouvrage, j’ai tenu à mobiliser ou à créer moi-même des concepts en évitant d’avoir directement recours aux concepts deleuziens (devenus usuels, voire rebattus) de l’image-mouvement et de l’image-temps. Bien que Deleuze révèle sans doute quelque chose de vrai au sujet de l’un des mouvements de fond qui se trament dans le cinéma d’après-guerre et qu’il allie ces deux grandes catégories à d’autres sous-catégories qui enrichissent notre compréhension du cinéma (perception, action, cristal, etc.), le bagage conceptuel dont il nous fait cadeau m’a toujours semblé un peu éloigné de la nature de plusieurs des films dont il parle. Et il en va ainsi à plus forte raison des films dont il ne parle pas ou ne peut guère parler en raison du moment où il est décédé. Et parmi ces films, figurent évidemment ceux du renouveau.
Dans quelle direction ma propre réflexion s’est-elle engagée ? Elle a gravité pour l’essentiel autour du sens commun – dont je dégage trois significations principales (objective, subjective, pratique) –, de l’ordinaire, du travail sur l’image et du réel (concept que j’associe au monde extra-mental en faisant écho à certaines thèses des réalistes spéculatifs). Pour bien faire comprendre en quoi les cinéastes du renouveau innovent par rapport aux « pères fondateurs » du cinéma québécois, on devrait remonter en toute rigueur à Léo-Ernest Ouimet, à Jean-Marie Poitevin et à Maurice Proulx, pour ne mentionner qu’eux, et clarifier ce qu’ils introduisent de singulier au sein de l’art filmique. Mais ce sont bien davantage les représentants du cinéma direct, ainsi que les cinéastes influents des années 1960 et 1970, que l’on considère généralement comme les « vrais pères fondateurs » du cinéma québécois, en raison de l’importance particulière de leur travail. C’est donc surtout sur eux que je me concentrerai ici, sans vouloir négliger les mérites de leurs devanciers.
Tandis que Perrault carburait au documentaire, les cinéastes du renouveau baignent surtout dans la fiction. Je m’étais intéressé à l’œuvre de Perrault dans un livre paru en 2016 et qui avait été coécrit avec Olivier Ducharme : Une vie sans bon sens. Regard philosophique sur Pierre Perrault. À rebours des commentateurs qui ont voulu en faire un cinéaste de fiction mal assumé au motif qu’il lui arrivait de nier l’intervention subjective qu’il faisait subir au métrage (par son dialogue avec les filmés, ses mises en situation, son montage, sa narration ponctuelle, etc.) [4], j’assume tout à fait la portée objective et réaliste de ses films. Chez Perrault, en effet, la réalité est souvent réfléchie comme étant en continuité ontologique avec les moyens techniques du cinéma direct, de sorte qu’il n’y a plus lieu de soupçonner ces moyens de corrompre notre accès au réel. Cela nous force à réviser ce qu’avançait Dominique Noguez dans un livre par ailleurs classique et intéressant : Essais sur le cinéma québécois. Certes, le rêve peut influencer la réalité et ainsi rejoindre cette réalité même. Mais rêve et réalité peuvent et doivent être distingués dans une certaine mesure, faute de quoi on ne pourrait plus expérimenter leur saveur propre, ainsi que l’a bien montré Françoise Lavocat dans Fait et fiction. Pour une frontière. Or, cette distinction entre le domaine onirique et le domaine factuel n’empêche pas de reconnaître que la subjectivité humaine peut, lorsqu’elle emploie certains moyens précis, dans une création cinématographique par exemple, devenir à même de révéler diverses parts du réel, si bien qu’un pont peut occasionnellement être effectué entre le sujet-rêveur et l’objet-réel. Et c’est à la construction de ce pont qu’a travaillé Perrault lui-même au sein de ses documentaires directs, souhaitant toujours mettre la technique cinématographique au service de la vie.
Dans Philosopher à travers le cinéma québécois, je ne me détourne pas complètement du champ documentaire puisque je parle de Bestiaire, mais je m’attarde davantage sur les manières dont le cinéma de fiction peut parvenir à exprimer le réel. Je prends ainsi le contrepied des théories qui se contentent d’insister sur le fait que la réalité au cinéma est nécessairement médiatisée – puis soi-disant dénaturée selon certains – par le langage, l’esprit, l’affectivité, le contexte institutionnel et le récit (la sémiologie, le cognitivisme, la sémio-pragmatique, la narratologie, etc.). Mon analyse est donc avant tout ontologique, bien qu’elle ne néglige pas les moyens particuliers qu’empruntent les cinéastes pour parler de l’être. Cet attachement à la réalité ontologique depuis l’intérieur même de la fiction cinématographique me semble permettre de distinguer, au moins dans une certaine mesure, les cinéastes du renouveau des réalisateurs (par ailleurs stimulants) dont l’œuvre est quelquefois axée davantage sur le domaine onirique : Norman McLaren, André Forcier, Gilles Carle, Jacques Godbout, Pierre Harel, Claude Jutra [5], Micheline Lanctôt (pour l’éclatant Sonatine), Denys Arcand (pour Jésus de Montréal notamment), Jean-Claude Lauzon…

Maxime Collin dans Léolo « Parce que moi j’m’appelle Leolo Lauzone » (image tirée du film – collection filmsquebec.com)
Dans Léolo par exemple, on entend résonner cette phrase comme un leitmotiv : « Parce que moi je rêve, moi je ne le suis pas ». Ce propos témoigne d’un certain désir de résister au réel à travers le rêve – comme si le rêve était le seul moyen d’éviter le vaste délire dans lequel nous plonge la réalité actuelle. Qu’on me comprenne bien : je suis loin de mépriser Léolo ; j’adore ce film autant pour des raisons objectives (son esthétique, sa musique, divers moments scénaristiques) que subjectives (cette œuvre a marqué mon enfance et c’est après l’avoir revue que ma compagne Julie Demers et moi avons échangé un premier baiser !). Mais le type de résistance au réel dont il est parfois question dans Léolo me semble poser problème. D’une part, il est faux de croire que la réalité en général mérite continûment un vaste effort de résistance ; d’autre part, c’est à condition de rester au cœur même du réel que l’on peut parvenir à le transformer de façon efficace. Et justement, dans plusieurs des œuvres du renouveau, il ne s’agit pas tant de résister au réel que de le transformer de l’intérieur. Les œuvres du renouveau ne cultivent pas le statu quo, mais elles ne se contentent pas non plus d’offrir une variation parmi d’autres sur le prétendu pouvoir de l’imagination, qui risque justement de conduire à l’autotélie. Elles prennent la réalité à bras-le-corps, dans un régime de fiction qui n’a rien d’autoréférentiel. Même chez l’un des cinéastes les plus idiosyncratiques du renouveau, Denis Côté, on rencontre d’ailleurs des personnages ni tout à fait marginaux ni tout à fait conformistes, donc soucieux d’avoir un pied dans le réel concret.
L’analyse que je mène dans mon livre me conduit d’autre part à conclure que les œuvres du renouveau ne correspondent pas vraiment à la caractérisation qu’en propose Matthew Rankin lorsqu’il emploie, avec un humour pince-sans-rire pour lequel je lui tire mon chapeau, l’expression de « réalisme suicidaire ». Cette expression peut être éclairée ainsi : « Depuis une décennie, le cinéma québécois semble s’enfoncer dans une espèce de Weltschmerz nihiliste et austère que je me plais à nommer le réalisme suicidaire. Un mouvement qui se caractérise par son intérêt pour une forme de mélancolie, morne et inconsolable, doublée d’une préoccupation thématique constante pour le suicide. Un film placé sous le signe du réalisme suicidaire se concentre le plus souvent, mais pas toujours, sur un personnage masculin aux prises avec une dépression que rien ne semble pouvoir soigner. » [6] Si l’épithète de réalisme suicidaire s’applique assez peu aux œuvres du renouveau, me semble-t-il, c’est notamment parce qu’elles s’avèrent au final souvent plus électrisantes et galvanisantes qu’elles ne le semblent au premier abord. En attestent divers films de Xavier Dolan, mais aussi plusieurs scènes ou différents moments d’En terrains connus, Tu dors Nicole, Curling, Camion… Dans mon ouvrage, j’ai tenté de clarifier cette thèse notamment en montrant que certaines œuvres du renouveau font tourner leur propos, non pas autour de la banalité quotidienne (tendance répandue dans le cinéma moderne), mais bien davantage autour de l’ordinaire, concept que je définis en détail dans le livre et qui a partie liée avec l’abstraction, donc avec une certaine distance, un certain recul intellectuel, suivant une analyse développée par Barbara Formis et que je prolonge à ma manière.
L’un des autres foyers d’intérêt centraux du renouveau me semble correspondre aux phénomènes de la critique constante et du devenir-intense en société. D’abord, le thème de la critique constante. Il serait exagéré de dire que les œuvres du renouveau sont apolitiques, puisqu’elles abordent à leur manière les enjeux sociaux. Il est vrai en revanche d’affirmer qu’elles examinent ces enjeux avec une certaine distance, voire avec une certaine prudence au sens aristotélicien du terme. C’est évident chez Denis Côté, Stéphane Lafleur, Rafaël Ouellet et, surtout, chez Mathieu Denis et Simon Lavoie. Dans Laurentie notamment, on observe un jeune homme qui, victime de ce que Cavell appelle le « scepticisme vécu », c’est-à-dire une forme d’isolement et de mutisme, accumule de jour en jour une rage qu’il finit par extérioriser en commettant un geste absurde et barbare : l’assassinat de son voisin. Plusieurs commentateurs ont reproché à Denis et Lavoie l’ambiguïté avec laquelle ils abordent ce sujet à l’écran. Mais il va de soi qu’ils n’encourageant aucunement semblable conduite. Et je crois pour ma part qu’à travers leur scénario et leur mise en scène, qui privilégie les plans-séquences pour accentuer l’effet de longueur et dévoiler le réel dans sa « totalité » plutôt qu’en fonction de simples « tranches de vie », s’articule un rejet tout à la fois du silence intégral (pratique qui conduirait à l’immobilisme) et de l’indignation constante (tendance répandue qui se manifeste dans les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi dans certains cercles académiques, voire chez toute personne qui n’a que de mauvais mots à adresser aux autres).
Comme l’avait jadis enseigné Socrate sans renoncer à faire appel à l’ironie, la philosophie est avant tout affaire d’autocritique : avant de prétendre connaître quoi que ce soit avec certitude et de juger avec fermeté des croyances et des attitudes des autres, il faut prendre la mesure de sa propre ignorance et purifier son esprit des faux savoirs. Or, à force de proclamer à tout vent que la philosophie est destinée à « éveiller l’esprit critique des gens », comme on le fait couramment de nos jours, on oublie parfois que cet éveil critique doit s’accompagner, comme une condition sine qua non, d’un travail préalable d’autocritique. Sans ce travail sur soi, on se condamne à vivre dans un grand parc pour adultes, où tous et chacun évoluent dans une éternelle « phase du non » et négligent de voir ce que le dialogue peut apporter de neuf à leurs propres pensées, leurs propres croyances, leurs propres convictions. Et c’est en partie avec cette idée que nous invite à renouer le cinéma de Denis et Lavoie, dans une pénétrante recherche d’équilibre entre le silence et la prise de parole.
Qu’en est-il maintenant du devenir-intense, concept philosophico-romantique qui évoque ici la quête de singularité, de nouveauté et d’expérimentation ? Il joue un rôle principiel depuis Nietzsche jusqu’à Deleuze, y compris dans le monde du cinéma, comme dans Endorphine d’André Turpin, diverses œuvres de Godard, Cronenberg, Jarmusch, Lipsett, Dupieux… Dans ma thèse doctorale qui ne se trouve reprise qu’en partie dans mon livre, j’étais assez critique à l’égard de plusieurs thèses deleuziennes. Et lorsque j’en parlais en bien, c’était souvent dans l’intention de réinterpréter Deleuze en un sens dans lequel on l’interprète plus rarement (par exemple, comme penseur d’un certain type de sens commun ou comme critique d’un certain type de marginal : celui qui est infatué). En examinant les œuvres de Stéphane Lafleur, de Denis Côté et d’Anne Émond, on voit s’épanouir cette idée que le réel n’est ni entièrement labile ni entièrement stable. Cette idée est pertinente et originale, puisqu’elle permet de réviser certaines convictions répandues en philosophie et en cinéma.

Réal Bossé dans le film Continental un film sans fusil de Stéphane Lafleur (©micro_scope)
Quelques exemples en rafale : l’œuvre de Lafleur passe d’une vision plutôt austère à une vision plutôt gaie de l’ordinaire du banlieusard, de Continental, un film sans fusil à En terrains connus, films auxquels s’ajoute Tu dors Nicole qui en constitue en quelque sorte la synthèse. Lafleur donne ainsi à comprendre que la vie humaine n’a ni à être synonyme de renouvellement incessant, ni à être synonyme de surplace. Dans Carcasses et Bestiaire de Denis Côté, le cinéaste oscille d’une valorisation du devenir accru à un certain intérêt manifesté à la stabilité, en plus de révéler que le réel n’est ni entièrement construit par le regard humain ni entièrement absolu, puisqu’il peut être l’un ou l’autre : c’est-à-dire observé par l’humain, ou délaissé par lui. Dans Nuit #1 d’Anne Émond, deux jeunes gens font l’épreuve du sentiment de lassitude qui naît lorsqu’on se borne à rechercher sans cesse les sensations fortes (dans les relations sexuelles et la drogue, mais aussi, pourrait-on ajouter, dans les arts et les sports qui doivent aujourd’hui plus que jamais être « extrêmes »). Nuit #1 ne désavoue pas sans détour la quête d’intensité contemporaine, mais vient mettre en exergue ses limites par un recours au dialogue intime. Ce geste filmique anticipe quelque peu ce que théorisera plus tard en philosophie Tristan Garcia dans La vie intense. Une obsession moderne. En somme, les films du renouveau abordent le réel en cultivant un certain goût pour l’entre-deux – thème qui était déjà quelque peu préfiguré dans l’œuvre de Perrault, laquelle se situait à cheval entre le classicisme et la modernité, encore qu’il arrivait à Perrault de basculer assez nettement dans le devenir [7].
Et le cinéma dit commercial, dans tout ça? Est-il lui aussi porteur d’un sens commun?
Le cinéma commercial est-il porteur d’un sens commun ? Assurément. Et peut-être même trop dans certains cas… C’est du moins ce qu’a voulu faire comprendre Adorno lorsqu’il a expliqué que la culture de masse réduit, voire risque d’annuler, la distance que l’on peut prendre par rapport au monde dans lequel on vit. À force de nous faire converger en commun vers certaines croyances et certaines pratiques, à travers une esthétique léchée et des scénarios souvent convenus dont la nature est régulièrement contaminée par les exigences financières, le cinéma commercial court le risque de nous piéger dans l’homogénéité. Néanmoins, comme Adorno l’a lui-même reconnu dans des textes plus méconnus et dignes d’intérêt, et comme Ludvic Moquin-Beaudry l’a examiné dans un ouvrage récent, Cinéma critique. Adorno, de Francfort à Hollywood, le cinéma comme art populaire possède aussi des vertus potentielles, dont l’une des plus importantes est de révéler à l’écran notre condition sociale et de rassembler les consciences autour de projets.
Pour ma part, et en raison même des arguments que je viens de synthétiser ici, je considère que le cinéma commercial est capable du meilleur comme du pire. D’un côté, on verserait dans l’élitisme et l’étroitesse d’esprit la plus vile en suggérant qu’il ne se fait strictement rien d’honorable dans le cinéma commercial. De l’autre, et en contrepartie, on adopterait une attitude juvénile et rampante en croyant que le cinéma commercial représente une panacée. Quiconque suit un tant soit peu l’actualité académique et philosophique sait avec quelle fougue bon nombre de chercheurs défendent de nos jours les moindres manifestations de la culture populaire. Surtout en France, qui a longtemps accusé un certain retard en ce sens par rapport à la culture anglo-saxonne et aux autres cultures, moins imprégnées de classicisme, on lit et on entend souvent encore aujourd’hui qu’« il faut réhabiliter la culture populaire ». Comme si cette réhabilitation n’était pas largement réalisée depuis un bon moment, d’abord parce que la culture populaire occupe par définition beaucoup d’espace en société, ensuite parce que l’intérêt qu’on lui porte dans les cercles intellectuels ne date pas d’hier…
À en croire plus d’un, Star Wars n’aurait rien à envier à Platon et à Shakespeare. Je reconnais volontiers que Star Wars a ses mérites, qu’on peut épiloguer avec pertinence sur ses thèmes, sa mise en scène, sa capacité à rejoindre la population, etc. Je m’intéresse moi-même sans sourciller à la pop philosophie, à laquelle j’avais consacré un article dans Le Devoir [8] il y a quelques années. Dans Philosopher à travers le cinéma québécois, je n’hésite d’ailleurs pas à relever les possibles vertus de la culture populaire à l’aune du traitement de la langue québécoise, de la musique et des costumes dans Mommy de Xavier Dolan. Outre qu’elle peut parfois contribuer à révéler la part de vérité contenue dans certains lieux communs, que l’on snobe trop souvent, la culture populaire constitue, pourrait-on dire en résumé, « un terrain commun où peuvent se rencontrer, interagir sans voile et combler un manque d’être les trois personnages principaux » (p. 169) du film. La scène où les personnages dansent sur Céline Dion dans la cuisine, à cet égard, est magistrale et marquante ! Mais il serait incorrect de refuser d’admettre que des degrés de profondeur distincts caractérisent les diverses œuvres existantes, et de faire comme si la culture commerciale était immaculée. Bref, il faut apprendre à faire un tri parmi les œuvres, qu’elles soient populaires ou indépendantes.
S’il faut garder espoir en la culture commerciale (concept par ailleurs équivoque, que l’on pourrait tantôt rapprocher, tantôt distinguer de la culture de masse, de la culture populaire, de la culture vernaculaire, etc.), c’est en partie parce qu’elle est susceptible de souder les individus les uns aux autres, de sorte qu’elle est capable de devenir, au mieux, un véhicule de choix pour exprimer des idées et renforcer des pratiques qui nous tiennent à cœur. Quoi qu’il en soit, il m’arrive de rêver d’un cinéma qui ne serait ni simplement lié à l’industrie ni simplement lié à une vision d’auteur, petit rêve qu’a peut-être bien réussi à réaliser à sa façon, au moins dans une certaine mesure, Xavier Dolan jusqu’à Mommy. Et puisque je me mets ici à parler de rêve, pourquoi ne pas mentionner pour finir qu’il m’arrive aussi de rêver d’un cinéma qui ne s’adresserait plus simplement aux êtres humains, mais aussi aux animaux, aux végétaux, aux choses matérielles, voire au néant ? Car si le cinéma a démontré jusqu’ici avec éclat qu’il est capable de beaucoup pour nous, êtres humains, il reste encore à étudier ce dont il est capable pour ce que nous ne sommes pas, voire pour ce qui n’a jamais existé ni n’existera peut-être jamais. Mais c’est un autre débat, plus éthéré sans doute…
NOTES
[1] Patrick Robert, « Philosopher à travers le cinéma québécois : une entrevue avec Pierre-Alexandre Fradet », Pieuvre.ca, 20 février 2019, en ligne : http://www.pieuvre.ca/2019/02/20/culturel-cinema-philosophie-entrevue-fradet/ (consulté le 24 mars 2019).
[2] Voir Gilles Deleuze, « Pour en finir avec le jugement », in Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, p. 168-169.
[3] Stanley Cavell, La Projection du monde. Réflexions sur l’ontologie du cinéma, trad. de C. Fournier, Paris, Belin, 1999, p. 32. Je souligne.
[4] Perrault a dit par exemple, dans des phrases stupéfiantes de naïveté et de génie : « Je défends l’image que les pocailles m’ont donné [sic] d’eux-mêmes. Et la fidélité de nos instruments qui reproduisent intégralement la réalité. Et je n’en veux pas d’autre preuve que Léopold, 30 ans plus tard, que je retrouve dans sa cuisine. Quand je passe deux heures avec lui, j’ai l’impression de vivre un épisode de Pour la suite du monde [1963]. Léopold est encore aussi vrai que son image. Léopold continue d’être lui-même autant dans l’image que dans la réalité. » Pierre Perrault, Cinéaste de la parole. Entretiens avec Paul Warren, Montréal, L’Hexagone, 1996, p. 112.
[5] Voir par exemple cet ouvrage incontournable : Thomas Carrier-Lafleur, Une philosophie du « temps à l’état pur ». L’autofiction chez Proust et Jutra, Québec/Paris, Presses de l’Université Laval/Vrin, 2010.
[6] Matthew Rankin, « Quelques observations québéco-winnipégoises sur le réalisme suicidaire », 24 images (site web), 27 août 2014, anciennement accessible en ligne : http://revue24images.com/blogues-article-detail/2087 (consulté le 26 août 2016).
[7] Sur ce point, je me permets de renvoyer à certaines des analyses menées dans ce livre : Olivier Ducharme et Pierre-Alexandre Fradet, Une vie sans bon sens. Regard philosophique sur Pierre Perrault, Préface de Jean-Daniel Lafond, Montréal, Nota bene, « Philosophie continentale », 2016.
[8] Pierre-Alexandre Fradet, « Pour en finir avec l’ironie : la pop philosophie », Le Devoir, 27 avril 2013, accessible en ligne : https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo-histoire/376797/pour-en-finir-avec-l-ironie-la-pop-philosophie (consulté le 24 mars 2019).






